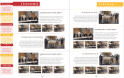Centrale du Bugey : le syndicat des vins du Bugey assigne EDF en justice
C’est à Culoz que le syndicat des vins du Bugey a tenu son assemblée générale le 14 mars, présidée par Jean-Luc Guillon. Il a notamment été question de flavescence dorée, de la baisse substantielle de récolte en 2024, la promotion de l’appellation, ou encore de l’assignation en cours d’EDF relative au changement de nom de la centrale nucléaire à Saint-Vulbas. Explications.

C’est acté. Le syndicat des vins du Bugey s’adresse à la justice pour obtenir le changement de dénomination de la centrale du Bugey. Après 15 années d’échanges infructueux (de 2010 à 2025) avec les représentants de la centrale nucléaire, différents ministères, élus territoriaux et parlementaires… la coupe est pleine pour le syndicat des vins qui avoue « n’avoir pas d’autre choix que de s’adresser à la justice pour faire reconnaître la primauté des droits de l’appellation qu’il représente ».
Un dialogue de sourds qui dure depuis 15 ans
Rappel des faits : la construction de la centrale nucléaire située à Saint-Vulbas a été autorisée par un décret du 22 novembre 1968 publié au Journal Officiel du 24 novembre 1968, et mise en service en 1972, sous le nom de « Centrale nucléaire du Bugey ». Or, le nom Bugey présente des antériorités plus anciennes : depuis 2009, l’ODG du Bugey défend les vins AOC Bugey, initialement reconnue en vin délimité de qualité supérieure par arrêté du 11 juillet 1958. Pour les viticulteurs et viticultrices, « l’emprunt du nom de l’appellation pour désigner une centrale nucléaire impacte péjorativement » leur travail et « dégrade l’image de l’appellation, de la qualité des vins et du terroir ». Toujours selon le syndicat, il en résulte pour l’AOC Bugey une mauvaise réputation infondée dont elle ne parvient pas à se défaire. Rappelant qu’il n’est pas contre l’énergie nucléaire, le syndicat entend s’acquitter de sa mission de protection et de défense de la dénomination « Bugey » afin d’éviter qu’elle soit irrémédiablement associée à l’image de la centrale. Pour mémoire, Jean-Luc Guillon, président du syndicat des vins, a rappelé que « les tous premiers échanges ont débuté avant 1990 et se sont formalisés après l’incident à la centrale du Tricastin en 2008, qui a engendré une baisse de 40 % du marché des vins et une baisse considérable de l’attractivité touristique. Autour des vins du Bugey, il y a d’autres organismes qui utilisent le nom Bugey, comme Bugey Sud ou Haut-Bugey. Derrière la valorisation de nos vins, il y a également la promotion de tout un territoire, d’un terroir et d’activités touristiques, ce que nous appelons l’œnotourisme ».
Patricia Flochon
Le chiffre : 12 365 hl
La récolte accuse une baisse de 41 % par rapport à l’année 2023, avec un volume de 12 365 hl ; la moyenne décennale se situe désormais à 20 396 hl
La culture de la vigne dans le Bugey : 23 % en HVE, 48 % en agriculture biologique et 29 % en conventionnel
Les opérateurs : 33 producteurs de raisins ; 74 viticulteurs ; 16 structures de négoce ; 3 conditionneurs.
Le marché : 10 % à l’export, 10 % en GMS/épiceries/magasins de producteurs, 25 % cavistes/CHR, 55 % en vente directe domaines viticoles.
Flavescence dorée : des résultats encourageants
Après cinq ans de lutte contre la flavescence dorée, le syndicat des vins dresse un bilan 2024 « très encourageant » (suivi des foyers sur le secteur de Cerdon et détection d’un nouveau foyer sur les communes de Ceyzérieu et Vongnes) appelant toutefois à rester vigilant. Concernant les parcelles en friche (les friches viticoles peuvent se révéler des réservoirs de maladies, vectrices de flavescence dorée), le syndicat se félicite d’un projet de loi en cours « visant à appliquer une sanction financière plus modérée ». Pour rappel l’arrachage des vignes en friche peut être ordonné si elles se situent à moins de 250 mètres du foyer en lutte obligatoire.